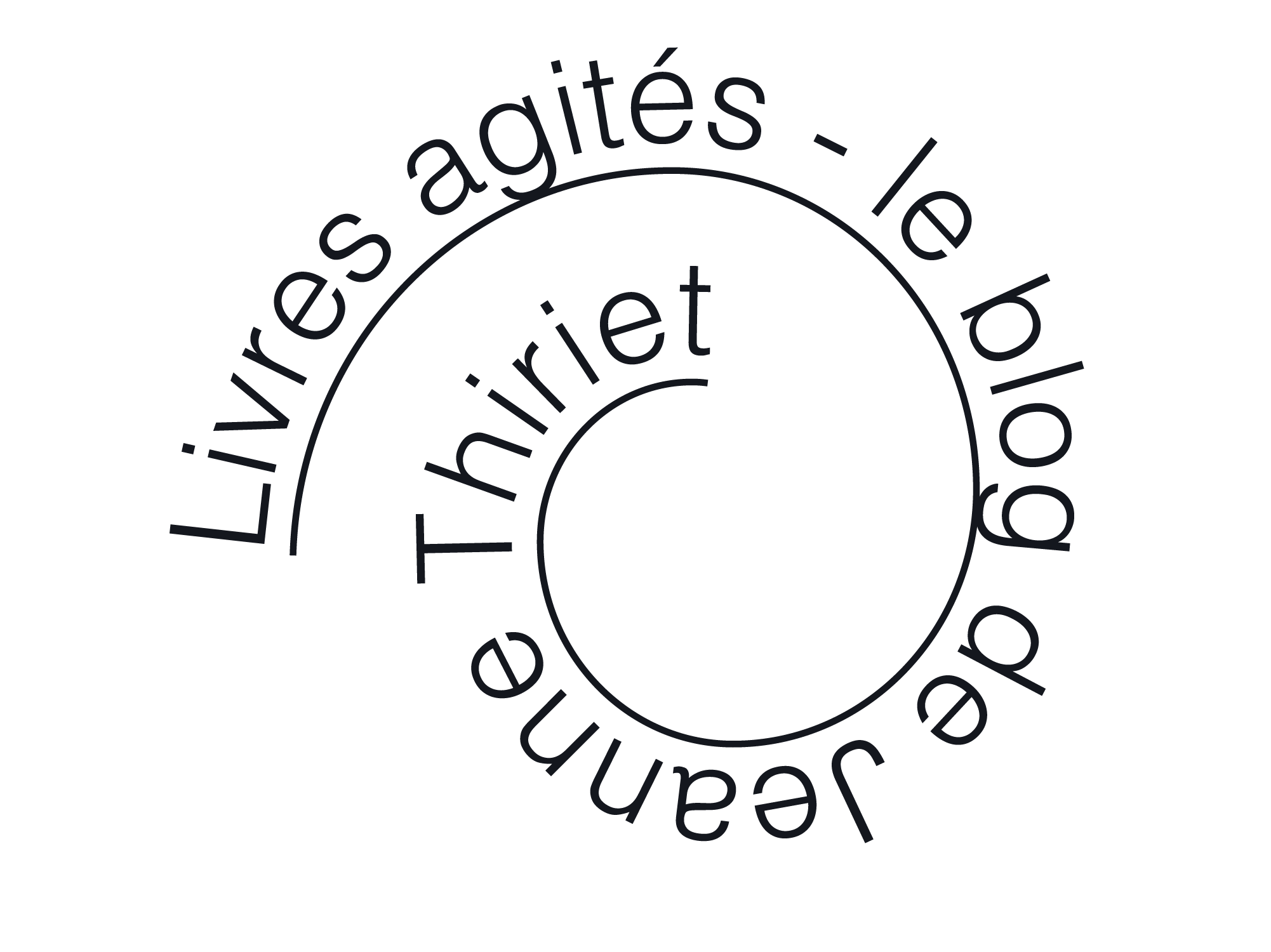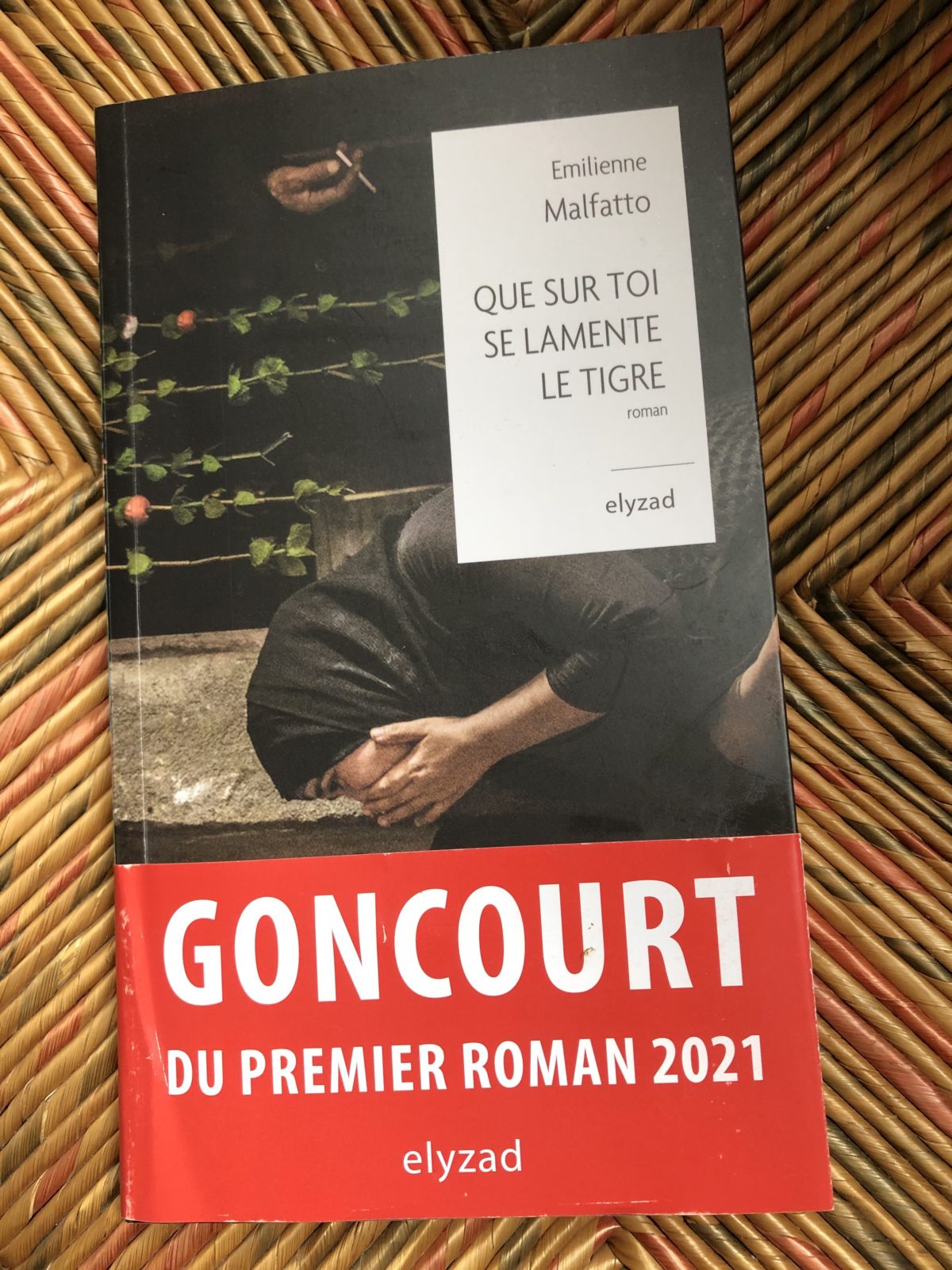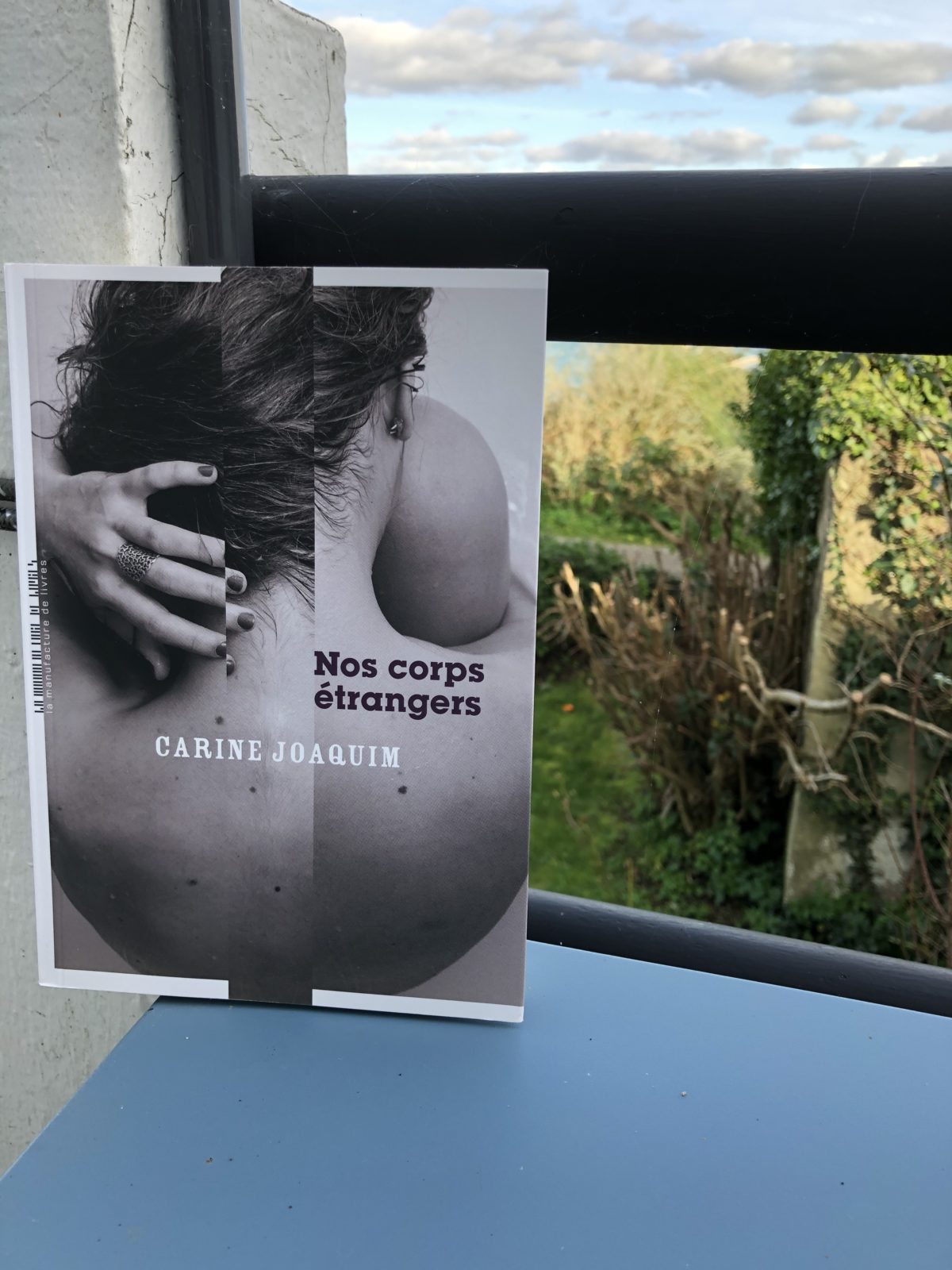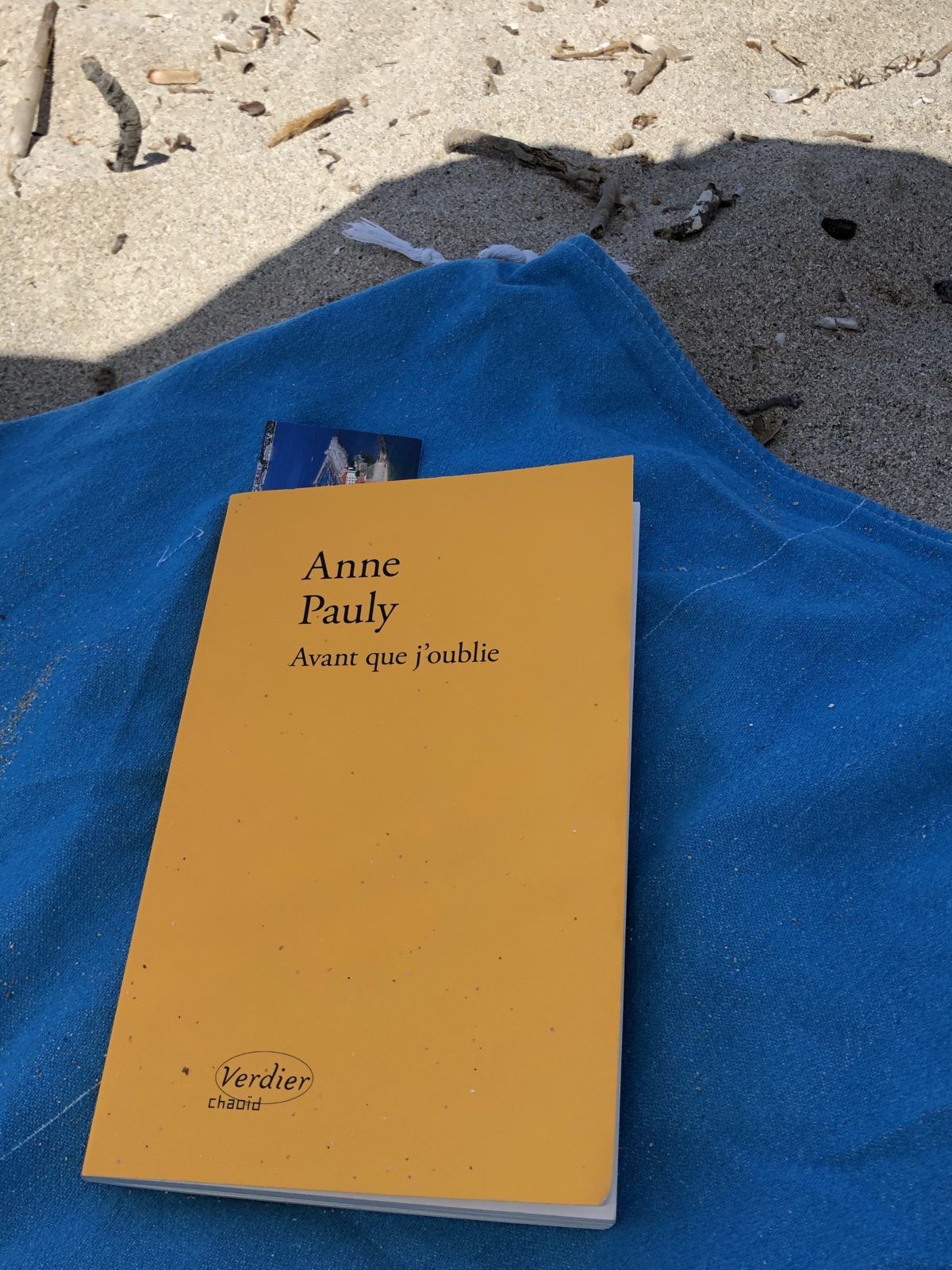Cet été, Amina Damerdji, primo-romancière, a bien voulu nous éclairer sur son travail pour faire revivre Haydée Santamaria, pasionaria cubaine, héroïne de son livre, « Laissez-moi vous rejoindre », publié chez Gallimard. Tout a commencé à Cuba, où elle a résidé quelques mois, pour faire du terrain pour sa thèse sur la poésie cubaine.
Comment est né l’idée de ce roman biographique ?
J’ai vécu à Cuba plusieurs mois… Ce qui est très particulier, pour nous, en arrivant, c’est qu’il n’y a pas de publicités sur les murs mais des affiches, des portraits des grands hommes de la révolution : Fidel, Camilo Cienfuegos, Raul, le frère de Fidel, tous représentés de manière virile, avec leur barbe. Alors, lorsque j’ai entendu parler d’Haydée Santamaria, elle a tout de suite attiré ma curiosité parce que c’est une femme. Souvent on parlait des femmes de la révolution comme femme de… Celle de Fidel qui s’était occupée du programme, celle de Raul en charge du droit des femmes. Pourtant Haydée jouissait d’une vraie notoriété et reconnaissance, en tant que femme d’état sur l’île ! Je travaillais beaucoup à la Casa de Las Americas qui est une véritable institution culturelle à La Havane, une bâtisse blanche, très jolie qui se détache dans le paysage de la ville, située sur le Malecon, (la promenade de front de mer) et où il y a un fond de bibliothèque plus important qu’ailleurs. En discutant avec les gens présents, un peu au gré des coupures d’électricité, j’ai appris que c’est elle, totale autodidacte, qui avait créé ce lieu culturel. Elle y a fait venir de grands écrivains sud-américains, Garcia Marquez, Cortazar et des Français aussi Sartre et Beauvoir…
Il y a une sensualité très forte et notamment gourmande dans votre récit , qui vous inscrivit dans la lignée des auteurs sud-américains comme Jorge Amado, pour ne citer que lui, qui émaillait ses romans de plats locaux ?
Oui la dimension sensuelle m’a clairement intéressée. D’abord parce que cela fait partie d’un patrimoine littéraire effectivement. Il y a des choses que j’ai aimé dans la littérature cubaine ou sud-américaine que j’avais envie de retrouver par l’écriture, des ambiances (la chaleur, la moiteur, des saveurs, des sons) mais aussi parce que je ne voulais pas faire une hagiographie politique mais m’intéresser à cette femme dans sa chair.
Et le choix de cette double temporalité, sa jeunesse et la genèse de son engagement, jusqu’à la défaite de la Moncada, et les quelques heures avant son suicide presque 40 ans plus tard?
J’ai été marqué par le livre d’un auteur cubain, Leonardo Padura, « L’homme qui aimait les chiens » et qui raconte la vie de Ramon Mercader, l’assassin de Trotski, exilé à Cuba. Il peint notamment cette forme très sacrificielle d’engagement, in fine assez déshumanisante. En développant la vision de la jeune Haydée et en contrepoint celle de l’Haydée plus mûre (57 ans) qui s’adresse à ces personnes qui fuient Cuba, je voulais mettre en regard deux moments de bascule de la vie de cette femme et raconter quelque chose du sacrifice politique et de l’idéalisme, de la désillusion.
Moi j’ai lu entre vos lignes un romantisme de la révolution…mais pas bêta !
Pour moi Haydée, au moment de son suicide, est justement cette femme qui a commencé sa vie, remplie d’idéaux romantiques, en quête de liberté pour transformer cette société cubaine. Forte de ses croyances puissantes, elle est emblématique d’autres jeunesses politiques, d’un type d’engagement qui s’est transformé aujourd’hui, n’emprunte plus les mêmes voies d’action.
Le fait qu’elle adresse son récit à ceux qui fuient,n’est-ce pas une façon de sortir du fantasme de la justice et justesse révolutionnaire?
Oui tout à fait pour moi, il y a vraiment l’élan de départ et la suite quelques années plus tard. Et d’ailleurs cela continue…
Tous ce groupe d’amis et frères d’armes, que vous décrivez, sont très vivants, comment avez-vous fait vos recherches ?
Je me suis documentée dans des livres d’histoire, sur place, à Cuba, puis de retour en Europe. J’ai aussi travaillé sur des archives numérisées, des documentaires et des captations trouvées sur internet.
Et vous avez pu recueillir des témoignages ?
J’ai aussi pu discuter avec plusieurs personnes qui l’avaient connue et beaucoup aimée en général.
Vous pouvez nous parler de ces poètes, sujets de votre thèse ?
Elle a porté sur un groupe de poètes qui sont passés de l’engagement officiel à la critique, et qui ont, pour la plupart, subi des mesures punitives, comme Luis Rogelio Nogueras, l’un des plus célèbres sur l’île, ou qui se sont exilés comme Raúl Rivero, le poète du groupe le plus connu à l’étranger, ou le romancier Jesús Díaz.
C’est donc votre premier roman, vous y pensiez depuis longtemps ?
L’idée a germé lors de mon dernier séjour à Cuba, en 2015. À ce moment-là, j’écrivais de la poésie. J’ai co-fondé une revue en 2011, qui s’appelle La Seiche, publié Tambour Machine en 2015 chez Plaine-Page et participé à plusieurs festivals de poésie orale. Je m’intéressais beaucoup à la poésie-action et à la performance. Quand j’ai commencé à m’intéresser à Haydée Santamaría à Cuba, je n’avais pas au départ le projet d’écrire un roman sur elle mais plus je me documentais et essayais de l’atteindre, plus elle s’éloignait de moi. La répétition des mêmes anecdotes, avec les mêmes mots, créait un voile de glace et finissait par figer le personnage au lieu de le rendre vivant. J’ai voulu, par la fiction, redonner vie à cette femme. Et à travers elle, raconter une histoire, celle d’un pays, d’un type d’engagement, mais aussi, celle de beaucoup d’autres femmes, d’un type de féminité assez peu représenté par la littérature..
Comment passe-t-on de la poésie au roman?
Au départ, le premier manuscrit écrit assez spontanément, était encore très poétique (cinq longues lettres qui ressemblaient plus à cinq longs poèmes en prose qu’à un récit romanesque !).Je l’avais envoyé à plusieurs maisons d’édition et reçu, au milieu de lettres type de refus, deux lettres plutôt encourageantes, avec des conseils de réécriture dont une des éditions Christian Bourgois. Mais ces conseils sont restés malgré tout un peu obscurs pour moi et puis ensuite, j’ai dû m’adonner à l’écriture de ma thèse et mettre de côté le projet. C’est un atelier Gallimard avec l’écrivain Hédi Kaddour, romancier venu également de la poésie, qui a agi comme un déclic pour moi. J’ai plongé dans un autre univers d’écriture, l’écriture romanesque avec ses personnages, sa sensorialité, sa narrativité, et ai commencé à me passionner pour cela. J’ai tout réécrit, de A à Z, et complètement différemment.
Et vous votre histoire Amina Damerdji ?
Je suis née aux États-Unis et j’ai ensuite grandi à Alger jusqu’en 1994. Ma famille et moi avons quitté l’Algérie pendant la Décennie noire (la guerre civile algérienne) d’abord pour la Bourgogne, où nous avons rejoint ma grand-mère qui en est originaire et s’était exilée avant nous, puis à Paris où j’ai fait le reste de ma scolarité et mes études. J’ai aussi vécu deux ans en Espagne, à Madrid.
« Laissez-moi vous rejoindre », Amina Damerdji, Gallimard