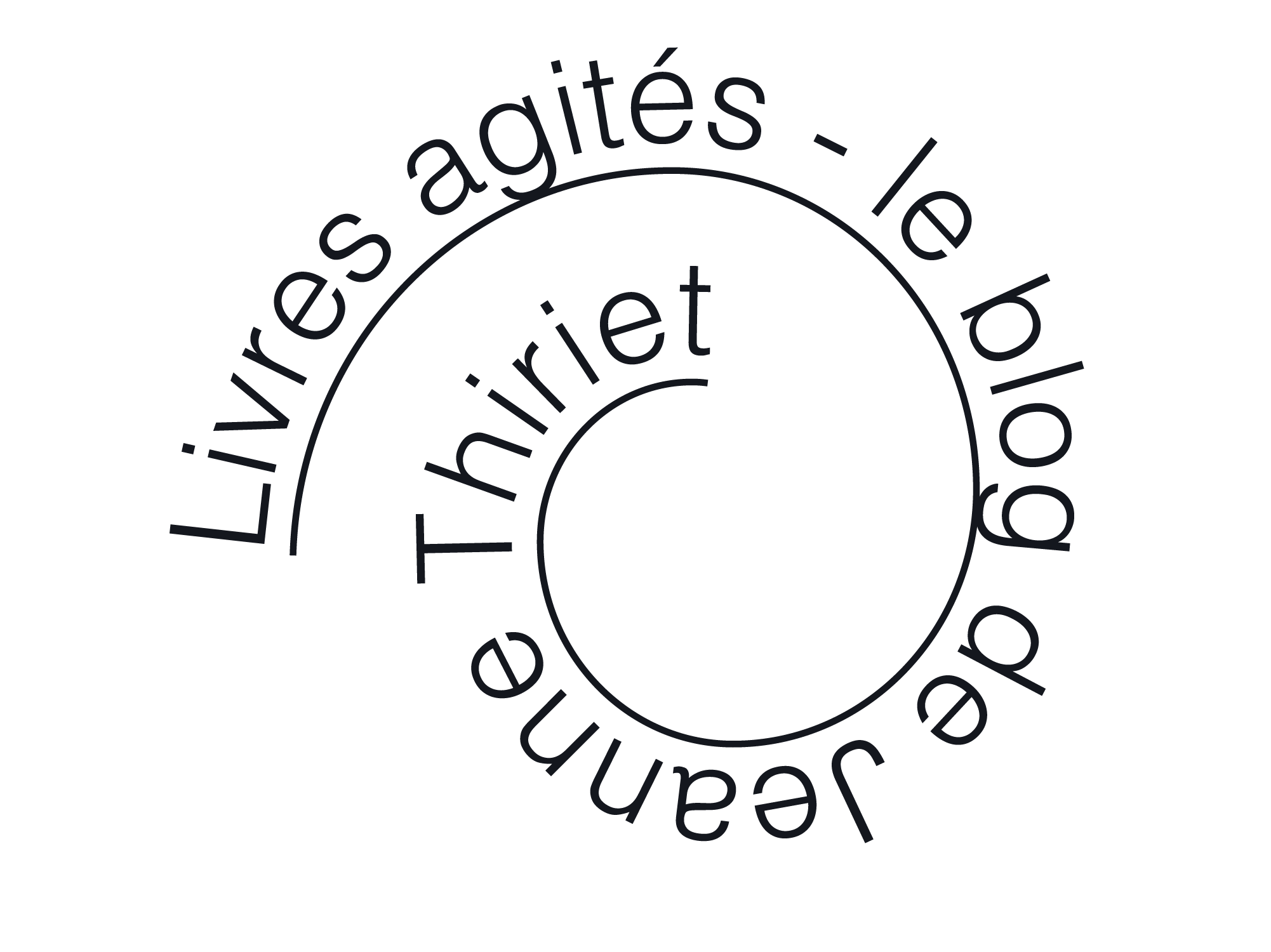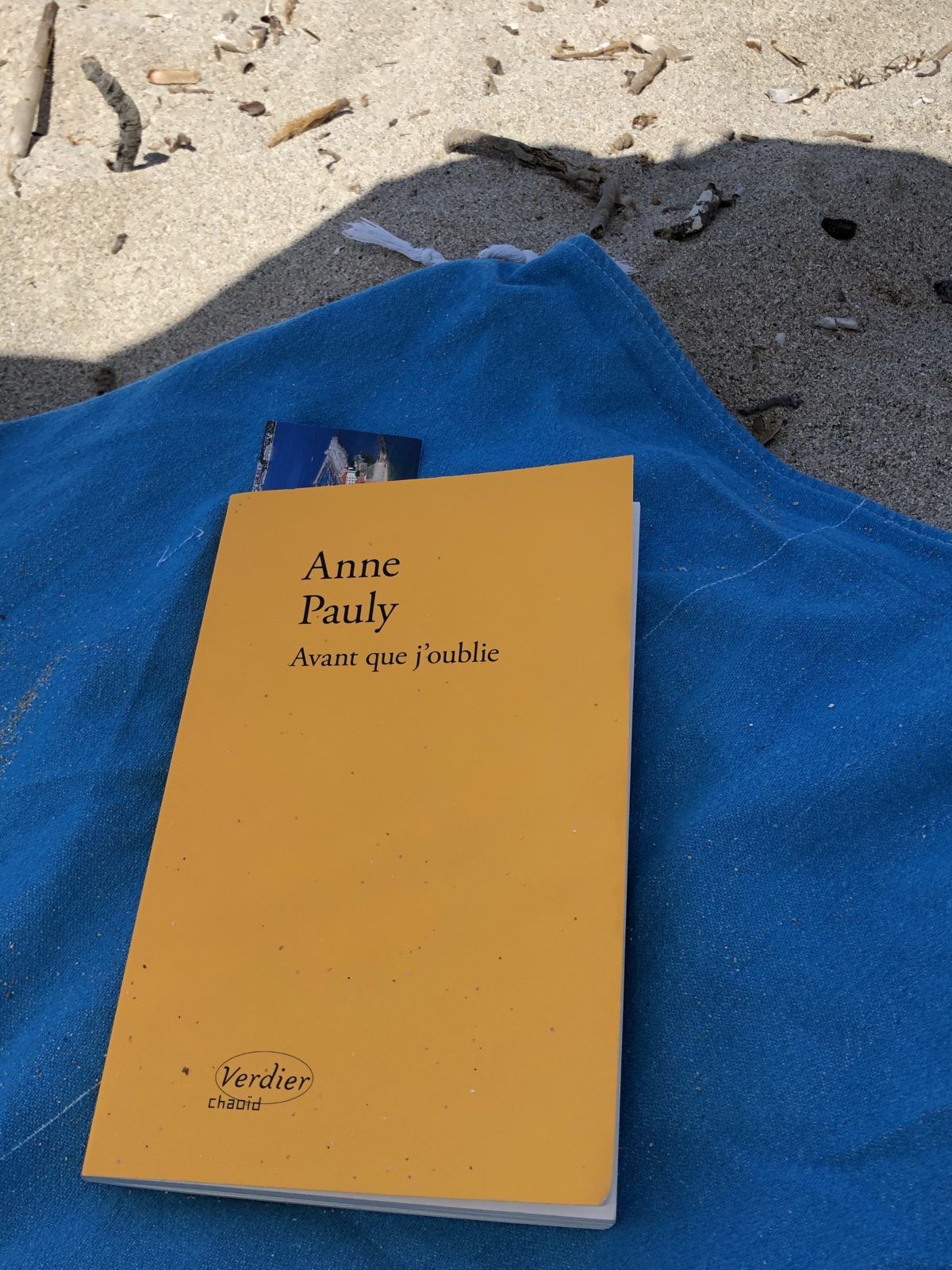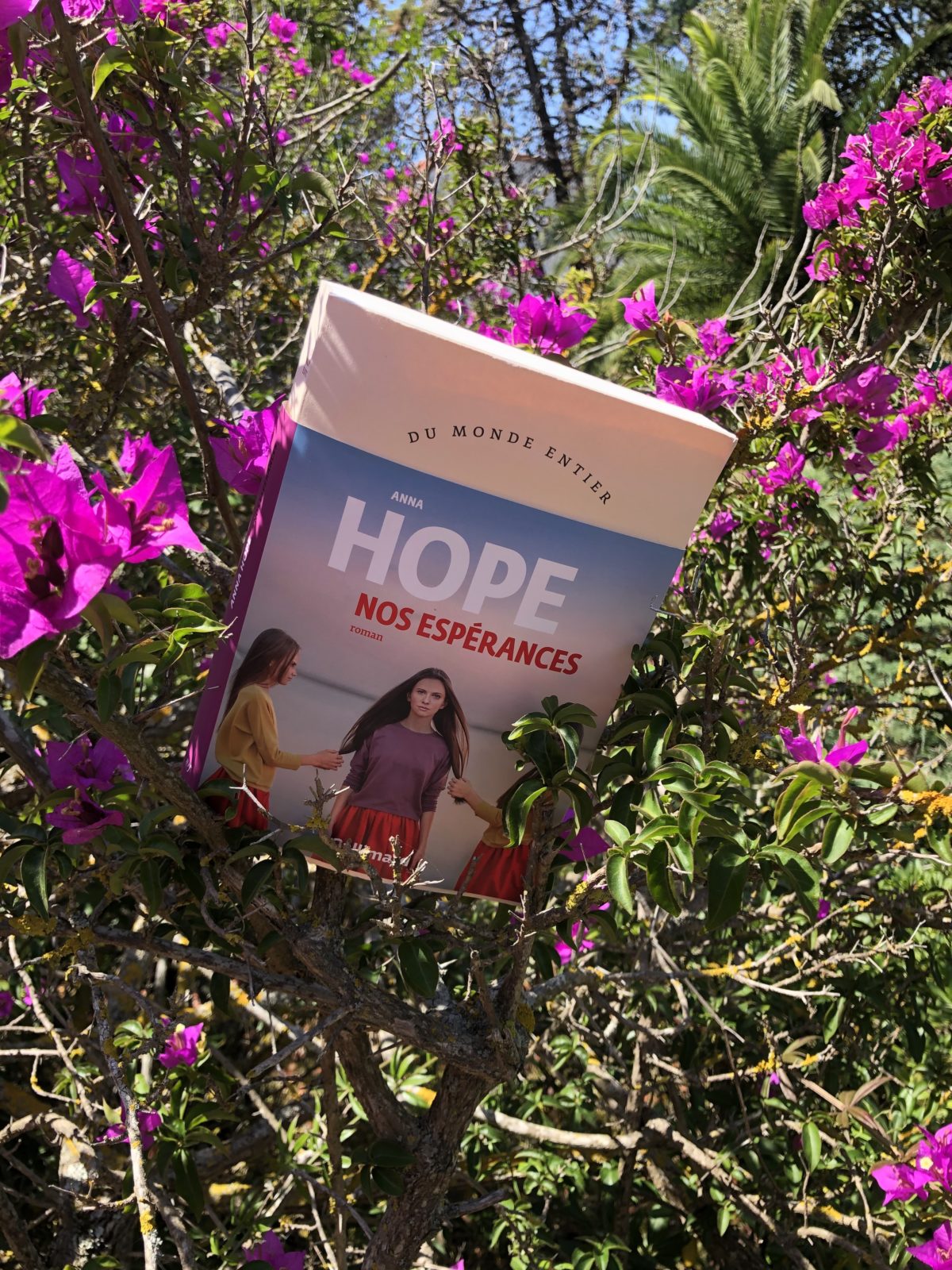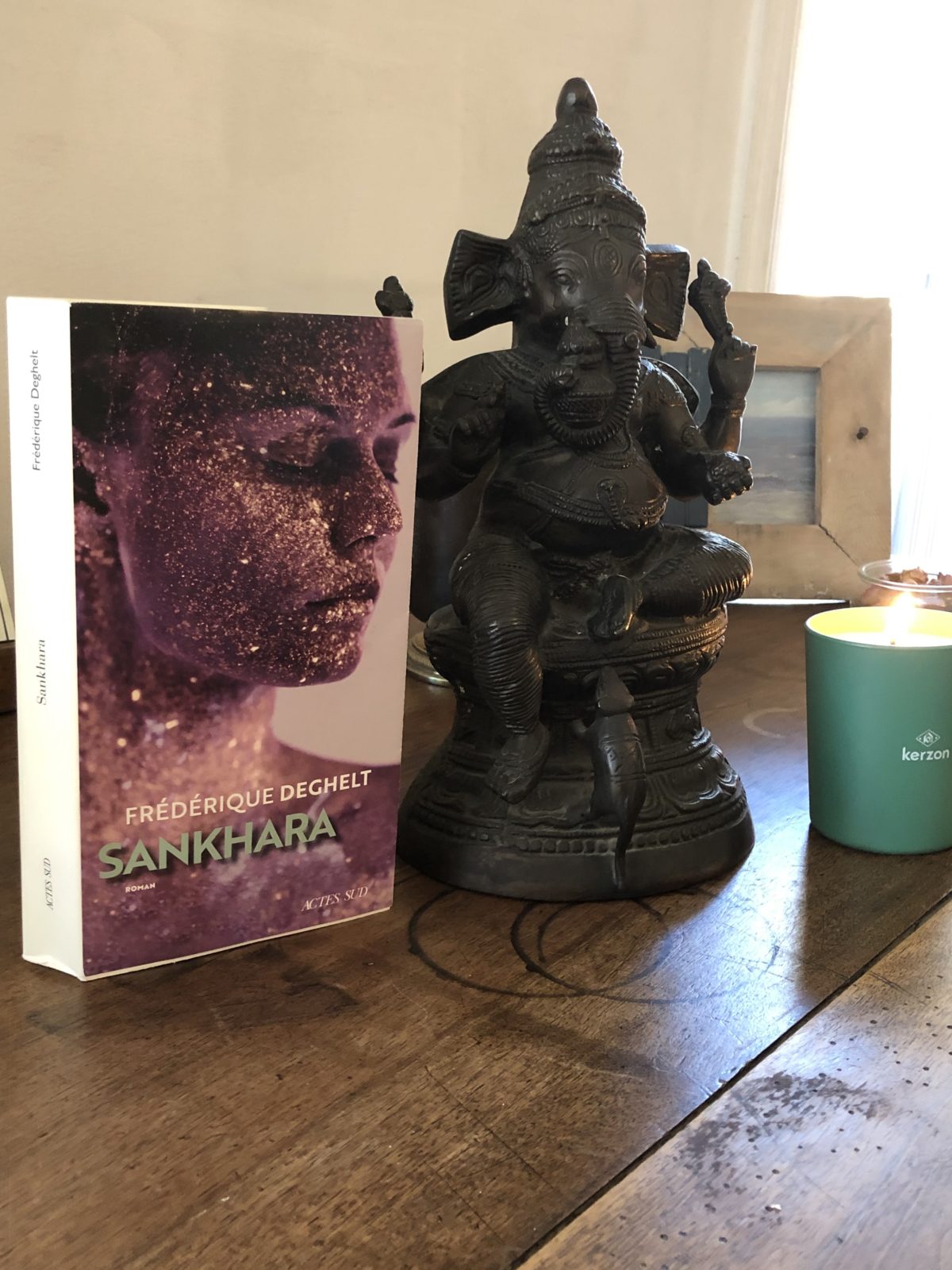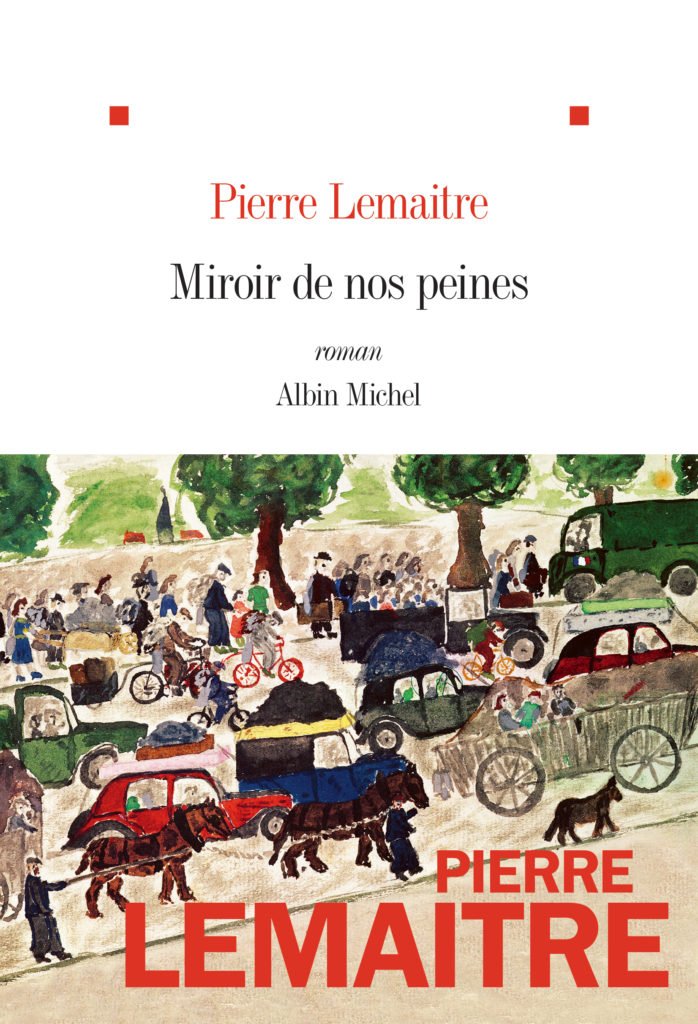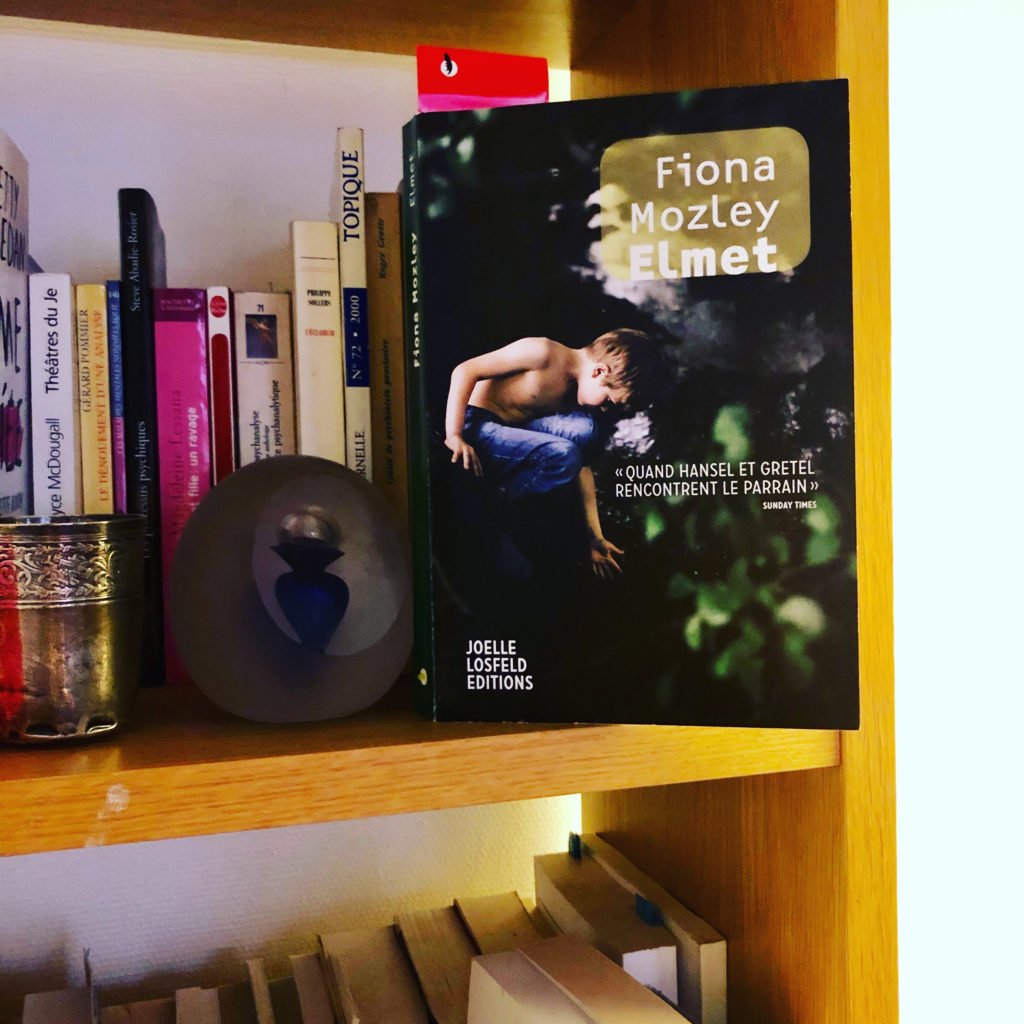Sorti en août dernier, après avoir tenu la corde dans les sélections du Goncourt et autre prix de la rentrée 2019, ce roman vient d’emporter le prix fameux du livre Inter. Et tant mieux, il caracole au top des ventes de cet été. Et pour une bonne raison : il se traverse et nous traverse.
La mort on n’aime pas trop en parler, hein ? Pourtant comment vivre sans ces deux bornes qui font la preuve de notre existence : la naissance et la mort. Et plus certainement celle d’un proche, aussi anonyme soit-t-il. C’est le roman du désarroi de ceux qui restent, sans bien savoir comment faire avec cela. Plus près de l’élégie que de l’éloge funèbre, Anne Pauly trace au mot à mot la perte d’un père pas si aimable et pourtant aimé. Elle parle même dans une interview récente sur France Inter d’un livre « mausolée » à la mémoire du sien.
Un père « gros déglingo »
La narratrice et donc l’autrice regarde son mort en face dans une approche toute phénoménologique, laissant à la porte de l’hôpital son imagination, pour observer le grand bouleversement d’un temps qui s’arrête alors que tout autour continue. Dans le même temps ce mort est son père qu’elle perd, comme une image qui s’évanouit, et pour ne pas l’oublier, elle le met en suspension, le temps de le reconstituer, de reconnaître sa vie au travers de petits bouts de lui collectés. Sans concessions. Sa brutalité détestable contre sa mère, son alcoolisme, ses silences rugueux, ses coups de sang inexpliqués mais aussi, toujours en contre-point, l’autre père, celui qui dévoile sa tendresse en même temps que ses obsessions de collectionneur de proverbes bouddhistes et de plumes d’oiseaux ou de maniaque du quotidien.
A chaque page elle soulève la poussière grise de l’armure du guerrier, peu admirable, et le dévoile à la lumière d’un quotidien qui, s’il n’a rien d’héroïque, ne manque pas de vie. Elle mène l’enquête et fait un inventaire à la Prévert avant de refermer la porte de cette vie envolée. Sans s’épargner non plus.
Peut-on aimer sa brute de père ? Oui ! Peut-on se transformer en mer de glace face à lui ? Peut-on être égoïste face à la maladie et la vieillesse ? Oui ! Surtout quand on a vu sa mère s’en prendre pleins la gueule… Peut-on lui rendre hommage ? Oui ! Parce qu’aucun de nous n’est fait d’une seule pièce et que parfois en grattant on peut trouver mieux que ce qu’il n’y parait.
Ce livre nous met face à nos morts comme une invitation à les conserver dans leur normalité dans un souvenir qui rend justice à ce qu’ils ont été. Anne Pauly invite à créer son rite singulier, son libre hommage, face à notre désarroi , dans un monde où les seuls rites mortuaires proposés sont un service payant.
Un roman vivant comme un pouls d’aujourd’hui
La langue d’Anne Pauly est franche, nette, sans fanfreluche, elle la puise dans l’honnêteté de la femme qu’elle est devenue, dans son origine sociale, celle des « nobody » comme elle dit, et dans son humour farceur venant panser la tragédie. Car on rit en lisant ce livre. Il en reste à la fin, cette poésie qui ne masque jamais la douleur d’une fille qui n’a pas manqué de père.
Extrait : « Que ses collègues qui l’appelaient Chipo parce qu’il pétait au bureau, lui accorde leur estime et le désignent comme porte-parole quand il fallait négocier avec le chef semblait lui avoir suffi. »
Avant que je l’oublie, Anne Pauly, Verdier Chaoïd, Prix du livre Inter